Théorie keynésienne :
le reste du monde
Politiques keynésiennes en économie ouverte
En toute rigueur, la théorie keynésienne n'est valide que dans le cadre d'une économie fermée, c'est-à-dire sans relations avec l'extérieur. Elle est donc valide pour l'économie mondiale considérée comme un tout mais non pour chaque pays pris isolément.
Dans une économie ouverte, les ménages peuvent acheter des produits et des actifs financiers non plus seulement dans le pays, mais également à l'étranger. Inversement, les agents économiques étrangers peuvent acheter dans le pays des produits et des actifs financiers.
Dans un pays donné, la demande intérieure est la somme la consommation et de l'investissement. À cette demande intérieure s'ajoute une demande extérieure égale aux exportations. Comme la demande totale est satisfaite à la fois par la production et les importations on a l'équation :
Production = consommation + investissement + exportations − importations
La différence entre les exportations et les importations est le solde de la balance des biens et services.
La bataille pour l'activité
Dans une économie ouverte sur l'extérieur, le revenu n'est plus égal à la production car des revenus peuvent provenir du reste du monde ou lui être payé. Dans ces conditions, le revenu national est égal à la production plus les revenus nets provenant du reste du monde, les revenus nets étant égaux aux revenus reçus moins les revenus versés. L'équation précédente devient donc :
Revenu = consommation + investissement + (exportations − importations + revenus nets provenant du RDM)
Soit :
Épargne = investissement + (exportations − importations + revenus nets provenant du RDM)
La partie entre parenthèses correspond à l'excédent courant de la balance des paiements. La relation entre l'épargne et l'investissement devient donc :
Épargne = investissement + excédent courant de la balance des paiements
Si l'on introduit une distinction entre public et privé l'équation précédente devient :
Épargne privée + épargne publique = investissement privé + investissement public + excédent courant BDP
C'est-à-dire :
Épargne privée = investissement privé + (investissement public − épargne publique) + excédent courant BDP
Si l'on fait l'hypothèse d'une absence de transferts en capital, la partie entre parenthèses correspond au déficit public. On a donc :
Épargne privée = investissement privé + déficit public + excédent courant BDP
Si l'on fait l'hypothèse que les entreprises distribuent tout leur revenu, l'épargne privée est l'épargne des ménages. Le taux d'épargne des ménages permet de passer de leur épargne à leur revenu. Le multiplicateur est égal à l'inverse du taux d'épargne.
Par exemple, si le taux d'épargne est de 20%, le revenu des ménages est égal à cinq fois leur épargne.
Le multiplicateur keynésien s'applique donc à l'investissement privé, au déficit public et à l'excédent courant de la balance des paiements.
L'investissement dans l'équation précédente est l'investissement net, c'est-à-dire qu'il est proche de zéro quand la croissance est faible. Dans ce cas, les deux éléments qui tirent la croissance sont le déficit public et l'excédent courant de la balance des paiements.
Le problème dans une économie ouverte est qu'une relance par les déficits publics peut être annulée par un déficit courant de la balance des paiements.
Une économie mondialisée
Plus précisément, dans une économie mondialisée où les produits et les capitaux circulent librement, la production n'est pas déterminée par le marché intérieur mais par une part du marché mondial. Si le pays est trop petit pour détenir une part significative du marché mondial, une politique de relance keynésienne n'a qu'un impact insignifiant sur l'activité et se traduit pratiquement exclusivement par la croissance des importations, c'est-à-dire par un déficit courant de la balance des paiements.
Dans une économie mondialisée, l'activité économique d'un petit pays est déterminée uniquement par sa compétitivité sur le marché mondial.
Pour un pays ayant un poids non négligeable dans l’économie mondiale, tout gain de part de marché se traduit pour les autres pays par une perte de part de marché et donc une baisse d’activité.
Pour montrer les interactions entre pays, nous pouvons partir d’un exemple simplifié.
Regroupons donc les pays en deux groupes se partageant à égalité le marché mondial et supposons que, dans chaque pays, le taux d'épargne des ménages soit de 20%.
L'économie mondiale prise dans son ensemble est une économie fermée et nous pouvons donc lui appliquer le modèle keynésien. Puisque le taux d'épargne des ménages est de 20%, le multiplicateur keynésien est de 5 et il s'applique à la somme de l'investissement mondial et des déficits publics de l'ensemble des pays. Partons d'une situation où l'investissement dans chaque groupe est de 100, où les déficits publics sont nuls et où les échanges extérieurs entre les deux groupes de pays sont équilibrés. L'investissement mondial étant de 200, la production mondiale est de 1000.
Supposons maintenant que le premier groupe de pays conquière une part du marché mondial de 60%, le deuxième groupe devant se contenter de 40%. Si nous supposons que dans chaque pays le taux d'épargne des ménages et l'investissement des entreprises restent inchangés, la production mondiale reste fixée à 1000. La production du premier groupe de pays passe donc à 600 et celle du second groupe passe à 400, c'est-à-dire qu'elle décroît de 20%.
La situation du second groupe de pays s'est nettement détériorée et du chômage risque d'apparaître. De plus, le solde de sa balance courante devient négatif.
En effet, la production et le revenu des ménages sont maintenant de 400, la consommation des ménages, est de 320. Comme l'investissement s'est maintenu à 100, la demande intérieure est de 420, c'est-à-dire que la production ne suffit pas à la satisfaire et que des importations de 20 sont nécessaires.
La dégradation du solde de la balance courante s'explique par une décroissance de la consommation des ménages moins rapide que celle de leur revenu du fait de leur taux d'épargne positif.
Ainsi, la perte de parts de marché s'est traduite concrètement pour le pays A par une baisse d'activité pouvant conduire à du chômage, par un déficit courant de sa balance des paiements et par une perte de contrôle d'une part du capital de ses entreprises puisque celles-ci ont dû se financer partiellement à l'étranger.
Ce dernier point est particulièrement important à comprendre. En effet, le solde de la balance courante des paiements et celui du compte financier de la balance des paiements sont nécessairement égaux en l’absence de transferts en capital. Ainsi, si l’on néglige les transferts en capital, un excédent de la balance courante des paiements correspond à une acquisition nette de créances du pays sur le reste du monde, un déficit de la balance courante correspond nécessairement à des acquisitions nettes de créances du reste du monde sur le pays.
Dans le compte du reste du monde présenté ci-après les augmentations doivent être comprises nettes des diminutions et les créances doivent être comprises nettes des dettes.
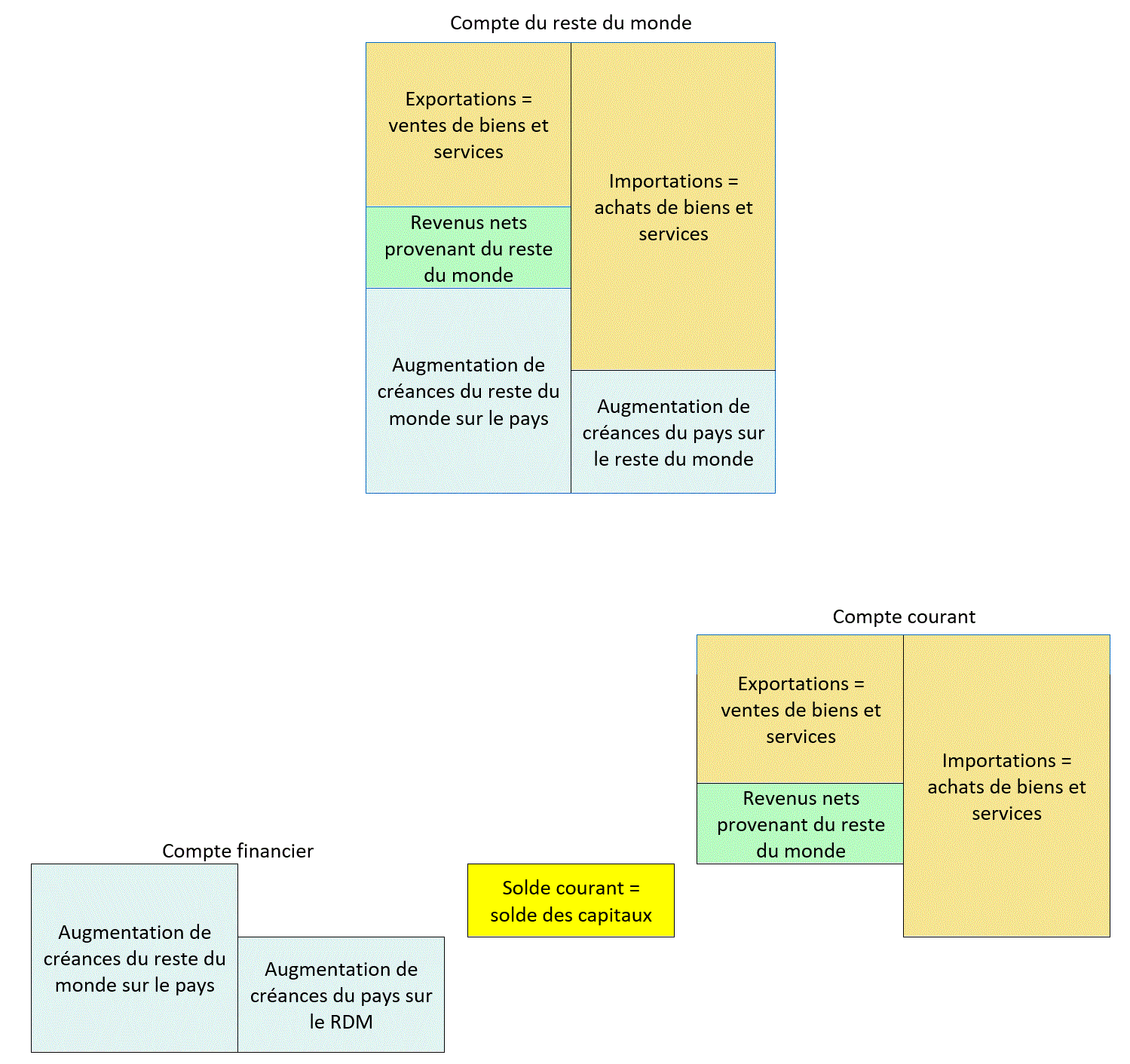
Les acquisitions nettes de créances du pays sur le reste du monde correspondent à des sorties de capitaux et des entrées de devises, les acquisitions nettes de créances du reste du monde sur le pays correspondent à des entrées de capitaux et des sorties de devises.
Dans un pays qui pratique une politique de taux de change flottant, les entrées et les sorties de devises ont tendance à s’équilibrer, un excédent courant de la balance des paiements correspond alors à des sorties nettes de capitaux, un déficit courant correspond à des entrées nettes de capitaux.
En d’autres termes, un pays dégageant un excédent courant de sa balance des paiements est un pays qui vend des produits au reste du monde et qui lui achète des actifs financiers, un pays subissant un déficit courant est un pays qui achète des produits au reste du monde et qui lui vend des actifs financiers.
Un secteur protégé de la concurrence extérieure
Certaines activités comme l'immobilier et les services aux ménages ne sont pas soumises à la concurrence extérieure. Ces activités sont dénommées présentielles, car elles sont liées à la présence de population. On peut également y inclure les services non marchands des administrations publiques si l'on considère qu'ils sont consommés globalement par les ménages et payés par leurs impôts.
Dans une économie ouverte, la répartition de l'activité entre le secteur concurrentiel et le secteur présentiel joue un rôle important. En effet, lorsqu'un pays connaît le chômage du fait d'un investissement net insuffisant, une politique de relance par les déficits publics peut avoir un effet positif sur l’activité du secteur présentiel.
Nous avons vu, en effet, que le revenu des ménages et donc leur consommation étaient stimulés par un déficit public. La croissance de la consommation n’a pratiquement aucun impact sur la production du secteur concurrentiel puisque celle-ci est déterminée par le marché mondial mais elle peut en avoir sur la production du secteur présentiel. Il suffit pour cela que la consommation des ménages se répartisse en proportions relativement stables entre produits du secteur concurrentiel et produits du secteur présentiel. Puisque, par définition, il n’y a pas d’importations de produits du secteur présentiel, l’accroissement de la consommation ne peut être satisfait que par un accroissement de la production.
Si cette politique de relance peut être suffisamment forte pour parvenir au plein-emploi, elle a aussi deux conséquences :
- une dégradation du solde courant de la balance des paiements car elle se traduit également par un surcroît de demande en produits du secteur concurrentiel qui ne peut être satisfait que par des importations ;
- l'affectation d'une plus grande part des ressources disponibles, notamment des emplois, au secteur présentiel.
Ce dernier point est particulièrement important. En effet, si la politique de relance se prolonge d'année en année, elle peut conduire à une modification durable de la structure de l'économie en faveur du secteur présentiel, ce qui signifie que le pays renonce à se battre sur les marchés extérieurs.
Cela signifie également que si l'investissement net se maintient durablement à des niveaux faibles, le pays ne pourra maintenir le plein-emploi qu'au prix d'un déficit public permanent. De plus, si en situation de plein-emploi la demande en produits du secteur concurrentiel dépasse sa capacité de production nationale, alors le pays est également condamné à un déficit permanent de sa balance des biens et services et même à un déficit permanent de sa balance courante si ses revenus nets provenant du reste du monde sont faibles ou négatifs.
La question se pose alors de la soutenabilité d'un déficit courant de la balance des paiements. D'une manière générale, une situation économique peut être supportée durablement tant qu'elle ne génère pas un appauvrissement global continu du pays. Or, l'investissement net représente l'accroissement du patrimoine national non financier et la capacité de financement de la nation représente l'accroissement de son patrimoine financier. La somme de l'investissement net et de la capacité de financement de la nation mesure donc l'enrichissement du pays pendant la période considérée. Si l'on néglige les transferts en capital avec le reste du monde, la capacité de financement de la nation est aussi égale au solde courant de la balance des paiements.
On en déduit qu’un déficit de la balance courante des paiements est durablement supportable tant qu'il reste inférieur à l'investissement net puisque, dans ce cas, la croissance du patrimoine non financier fait plus que compenser la dégradation du patrimoine financier. Inversement, un déficit courant n'est pas soutenable durablement s'il est supérieur à l'investissement net, ce qui est toujours le cas lorsque l'investissement net est nul.
Ainsi, un pays ayant une balance courante équilibrée ou déficitaire et un investissement net très faible ne peut relancer durablement son activité par un déficit budgétaire courant car celui-ci génère un déficit courant de sa balance des paiements supérieur à son investissement net, c’est-à-dire un appauvrissement continu du pays.
La bataille pour l'accumulation
L'accumulation d'un pays correspond à son épargne nette. Dans une économie ouverte, elle est égale à l'investissement net plus l'excédent courant de la balance des paiements. L'investissement net correspond à l'accumulation réelle du pays et l'excédent courant de la balance des paiements correspond à son accumulation en termes de droits sur le patrimoine des autres pays. En effet, si l'on fait l'hypothèse d'une absence de transferts en capital entre pays, l'excédent courant de la balance des paiements est aussi égal à la différence entre l'accroissement de ses créances sur le reste du monde et l'accroissement de ses dettes envers le reste du monde.
Lorsque la croissance est faible, l'investissement net est proche de zéro, si bien que la principale source d'accumulation devient l'accumulation de droits sur le patrimoine des autres pays.
C'est-à-dire qu'en période de faible croissance, l'accumulation d'un pays ne peut se faire qu'au détriment des autres pays.
Les véritables enjeux de la bataille économique apparaissent quand on se replace dans un cadre mondial. La production n'est plus déterminée exclusivement par la demande intérieure, certains pays ont des excédents courants de la balance des paiements et d'autres des déficits courants.
Considérons donc deux catégories de pays, les pays excédentaires et les pays déficitaires, ainsi que deux catégories d'activités, les activités concurrentielles et les activités présentielles.
L'économie mondiale étant une économie fermée, l'égalité entre l'épargne et l'investissement est toujours vérifiée. Les pays doivent ainsi se partager l'épargne mondiale et cette épargne est indépendante du niveau d'activité.
L'équation déterminant l'épargne dans une économie ouverte peut également s'écrire ainsi :
Excédent courant BDP = épargne − investissement
Un pays qui dégage un excédent courant de sa balance des paiements est donc un pays dont l'épargne est supérieure à son investissement, c'est-à-dire un pays qui accumule davantage que sa contribution à l'accumulation mondiale. Mais l'épargne est d'autant plus élevée que le revenu et le taux d'épargne le sont. Un pays qui donne la priorité à l'accumulation va donc chercher à accroître à la fois son revenu et son taux d'épargne.
Lorsque la croissance est faible, un pays n'a que deux moyens pour accroître son revenu :
- creuser son déficit public ;
- dégager des excédents courants de sa balance des paiements.
Une relance par les déficits publics consiste à augmenter l'épargne des ménages par une épargne négative de l'État. Dans une économie fermée, elle n'a pas d'impact sur l'épargne nationale qui est toujours égale à l'investissement ; dans une économie ouverte, elle dégrade l'épargne nationale puisqu'elle a un impact négatif sur l'excédent courant de la balance des paiements. Elle revient, en fait, à accroître le revenu en baissant le taux d'épargne du pays au prix d’une baisse de son accumulation.
Un pays qui donne la priorité à l'accumulation ne peut donc pas opter pour une politique de relance par les déficits publics, il doit nécessairement viser à accroître son excédent courant de la balance des paiements.
Un État peut difficilement faire croître le taux d'épargne des ménages sauf s'il accepte de favoriser les ménages les plus aisés au détriment des plus pauvres. Son principal moyen pour accroître le taux d'épargne national est donc de dégager des excédents budgétaires.
Le principal inconvénient d'une politique visant à dégager des excédents publics est son impact négatif sur l'activité, aussi n'a-t-elle réellement de sens que couplée à une politique agressive de conquête des marchés extérieurs. Dans ce cas, en effet, l'excédent courant de la balance des paiements peut conduire à une surchauffe de l'économie nationale qui mettrait en concurrence les secteurs concurrentiels et présentiels sur le marché de l'emploi.
Aussi, pour permettre la poursuite de la conquête de nouveaux marchés, est-il nécessaire de contenir la demande intérieure par un excédent budgétaire.
Cette politique visant à privilégier le secteur concurrentiel au détriment du secteur présentiel est celle qui permet l'accumulation la plus forte pour le pays.
Les excédents courants de la balance des paiements se traduisent également par un accroissement des créances du pays sur le reste du monde. À moyen et long terme, ces créances vont générer des revenus en provenance du reste du monde, ce qui améliorera encore le solde courant de la balance des paiements et créera un processus cumulatif favorable à la fois à l’accumulation et à l’activité.
Bien entendu, l'épargne mondiale étant égale à l'investissement mondial, si certains pays peuvent dégager une épargne supérieure à leur investissement, ce ne peut être qu'au détriment des autres pays.
Ainsi, très schématiquement, on peut regrouper les pays en deux catégories :
- des pays offensifs sur le marché mondial qui dégagent des excédents courants de leur balance des paiements et qui peuvent aller jusqu'à dégager des excédents publics pour contenir leur demande intérieure ;
- des pays sur la défensive qui ne peuvent maintenir un niveau satisfaisant d'activité que par des déficits publics et qui doivent subir des déficits courants de leur balance des paiements.
Il se crée un processus cumulatif puisque les déficits publics des uns génèrent un surcroît d'activité chez les autres qui les incite à accroître leurs excédents publics. En réduisant l'activité mondiale, ces excédents amènent les pays déficitaires à creuser encore davantage leurs déficits publics. Ce phénomène est renforcé par les revenus de la propriété venant des pays déficitaires vers les pays excédentaires.
Le problème est que ce processus ne peut se poursuivre indéfiniment. En effet, d'une part il est limité par la capacité des pays à maintenir durablement des déficits publics, d'autre part puisqu'il se traduit par un transfert de patrimoine d'un groupe de pays vers un autre, il s'arrête nécessairement quand les pays déficitaires ont atteint un certain niveau de pauvreté.
Politique monétaire en économie ouverte
Une réponse classique au manque de compétitivité d'un pays est une dévaluation ou une dépréciation de sa monnaie puisque celles-ci ont pour conséquence une baisse des prix nationaux par rapport à ceux des autres pays. Dans un pays où le cours de la monnaie est déterminé par les marchés, sa dépréciation peut être obtenue par une politique monétaire expansionniste.
En effet, l'investissement des entreprises se traduit par une émission de titres. À cet investissement correspond l'épargne des ménages, c'est-à-dire un accroissement de leur patrimoine. Les ménages vont décider de répartir cet accroissement de leur patrimoine entre titres et monnaie. Autrement dit, l’investissement des entreprises correspond à une offre de titres et l’épargne des ménages à une demande de titres et de monnaie.
Dans une économie fermée où les entreprises distribuent tout leur revenu aux ménages, l'investissement des entreprises est égal à l'épargne des ménages, si bien que l'offre de titres par les entreprises est égale à la demande en titres plus la demande en monnaie des ménages. Il y a donc un déséquilibre sur le marché des titres et sur celui de la monnaie qui peut se résorber de deux manières :
- la demande des ménages en titres peut croître grâce à une baisse de leur prix, c’est-à-dire une hausse du taux d’intérêt ;
- un autre agent peut venir offrir de la monnaie et demander des titres.
Les banques sont les seules à pouvoir créer de la monnaie et elles le font en achetant des titres. Les banques peuvent décider d’équilibrer le marché en offrant de la monnaie, c'est-à-dire en acceptant d’acheter des titres.
Puisque l'offre de monnaie par les banques est égale à leur demande en titres, on a sur le marché des titres :
Offre par les entreprises = demande des ménages + demande des banques
Si les banques décident d'équilibrer l'offre, le prix des titres, c'est-à-dire leur cours, ne varie pas. Si la demande des banques est insuffisante, le prix des titres va baisser, si la demande des banques est trop forte, le prix des titres va monter.
Lorsque les capitaux peuvent circuler librement d'un pays à l'autre, le marché des titres est mondial, ce qui a deux conséquences :
- l'offre et la demande de titres ne proviennent plus seulement de l'économie nationale mais aussi des autres pays ;
- le prix des titres exprimé en monnaie internationale n'est plus déterminé par le marché national mais par le marché mondial. Une demande nationale insuffisante ne se traduira alors plus par une baisse des prix mais par des ventes à l'étranger ; une demande nationale trop forte se traduira par des achats à l'étranger.
Ainsi, si l'on part d'une situation d'équilibre sur le marché des titres, un accroissement de la demande des banques va se traduire par des achats de titres à l'étranger, une baisse de leur demande va se traduire par des ventes de titres à l'étranger.
Il est nécessaire ici d'introduire les devises car les achats et les ventes à l'étranger doivent être réglés en devises. Il existe donc un marché national des devises.
Ce marché est alimenté comme le montre le schéma ci-dessous :
| Sorties de devises | Entrées de devises | |
| Importations = Achats de biens et services | Exportations = Ventes de biens et services | |
| Achats de titres financiers au reste du monde | ||
| Revenus nets provenant du reste du monde | ||
| Ventes de titres financiers | ||
| Solde = sorties de devises | ||
Pour parvenir à une dépréciation de la monnaie nationale, les banques peuvent procéder de deux manières :
- elles peuvent acheter des devises ;
- elles peuvent acheter des titres sur le marché national.
Dans les deux cas elles financent leurs achats par création monétaire, c’est-à-dire qu’elles pratiquent une politique monétaire expansionniste.
Lorsque les banques achètent des devises, elles font monter leur prix, c’est-à-dire qu’elles déprécient la monnaie nationale.
Lorsque les banques achètent des titres sur le marché national, l'augmentation de la demande de titres se traduit par des achats à l'étranger des autres agents et donc des sorties de devises. Les sorties de devises ont tendance à déprécier la monnaie nationale car la banque centrale qui gère les réserves de devises va remonter leur prix pour équilibrer le marché.
Dans un deuxième temps, la dépréciation de la monnaie nationale va influencer les importations et les exportations de biens et services en faisant baisser les prix des produits nationaux par rapport aux prix des produits étrangers.
Les exportations sont favorisées par la baisse de leur prix sur le marché mondial et les importations défavorisées par la hausse de leur prix sur le marché intérieur.
Cependant, la dépréciation de la monnaie a deux effets contraires sur les exportations :
- elle tend à augmenter leur volume ;
- en faisant baisser leur prix, elle tend à faire baisser leur valeur.
La dépréciation n'aura donc d'effet positif sur les exportations que si l'effet volume l'emporte sur l'effet prix.
De même, la dépréciation de la monnaie a deux effets contraires sur les importations :
- elle tend à faire baisser leur volume ;
- en faisant monter leur prix, elle tend à faire croître leur valeur.
Là encore, la dépréciation de la monnaie n'aura d'effet positif sur les importations que si l'effet volume l'emporte sur l'effet prix.
Globalement, une dépréciation de la monnaie n'aura d'effet positif sur la balance des biens et services que si la somme des élasticités-prix des importations et exportations en valeur absolue est supérieure à 1. C'est la condition de Marshall-Lerner.
L'élasticité-prix des importations incorpore toutefois un effet de revenu car la hausse du prix des importations fait baisser le pouvoir d'achat des ménages. À partir d'un certain niveau, la dépréciation de la monnaie finira donc bien par se traduire par une baisse des importations suffisante pour améliorer la balance des biens et services.
Les entrées de devises vont alors croître davantage que leurs sorties, ce qui tend à faire remonter le cours de la monnaie nationale.
Le schéma ci-dessous montre que si les banques maintiennent une forte demande en titres, elles peuvent provoquer des achats de titres à l'étranger suffisants pour garantir un excédent de la balance courante des paiements.
| Sorties de devises | Entrées de devises | |
| Importations = Achats de biens et services | Exportations = Ventes de biens et services | |
| Achats de titres financiers au reste du monde | ||
| Revenus nets provenant du reste du monde | ||
| Ventes de titres financiers | ||
Ainsi, dans des circonstances favorables, une politique monétaire expansionniste en économie ouverte où les capitaux circulent librement permet d'améliorer la balance courante des paiements. Elle a donc un effet positif sur l'activité économique mais elle se fait au détriment des autres pays.
Cette politique monétaire expansionniste se traduit aussi par de l'inflation du fait de la hausse du prix des importations consécutive à la dépréciation de la monnaie. Cette inflation rend les produits nationaux mois compétitifs, ce qui atténue puis annule les effets positifs de la politique monétaire sur la balance des biens et services.
Comme nous l'avons vu, un pays qui accroît sa part du marché mondial prend un avantage décisif sur ses concurrents. Une politique visant à déprécier la monnaie nationale peut être un moyen d'y parvenir mais ses effets ne sont que transitoires. Pour rééquilibrer durablement sa balance courante, un pays doit faire appel à d’autres politiques.
Le contrôle des capitaux
La libre circulation des biens et services n'implique pas nécessairement l'apparition d'excédents ou de déficits courants des balances des paiements des différents pays.
En effet, si l’on suppose l’absence de transferts en capital, le solde de la balance courante des paiements est égal à la capacité de financement de la nation. Cette relation n'est rien d'autre que l'expression dans le compte du reste du monde de la relation entre le solde des opérations non financières et celui des opérations financières.
Supposons qu’un contrôle par l’État des mouvements de capitaux permette d'équilibrer les entrées et les sorties de capitaux, c'est-à-dire les ventes et les achats de titres financiers. Dans ces conditions, un excédent ou un déficit de la balance courante des paiements ne sont possibles que par des entrées ou des sorties de devises.
| Sorties de devises | Entrées de devises | |
| Importations = Achats de biens et services | Exportations = Ventes de biens et services | |
| Revenus nets provenant du reste du monde | ||
| Ventes de titres financiers | ||
| Achat de titres financiers | ||
| Solde = sorties de devises | ||
En régime de change flottant, le marché détermine le taux de change de la monnaie nationale de telle manière qu'il équilibre les entrées et les sorties de devises. Lorsque l’État parvient à équilibrer également les mouvements de capitaux, l'équilibre du marché des devises assure en même temps l'équilibre de la balance courante des paiements :
| Sorties de devises | Entrées de devises | |
| Importations = Achats de biens et services | Exportations = Ventes de biens et services | |
| Revenus nets provenant du reste du monde | ||
| Achat de titres financiers | Ventes de titres financiers | |
Lorsque les mouvements de capitaux et de devises sont équilibrés, le solde du compte financier est nul, si bien que le solde de la balance courante des paiements est, lui aussi, nécessairement nul.
Les conséquences pour la théorie keynésienne en sont extrêmement importantes.
En effet, dans une économie ouverte, l'épargne est égale à la somme de l'investissement et du solde de la balance courante des paiements :
E = I + (X + T − M)
Lorsque le solde de la balance courante des paiements est nul, alors on retrouve l'équation keynésienne fondamentale :
Épargne = investissement
En cas d'équilibre de la balance courante des paiements, l'égalité entre l'épargne et l'investissement est à nouveau vérifiée. L'épargne des ménages est alors égale à la somme de l'investissement et du déficit public, le multiplicateur keynésien qui provient de la relation entre l'épargne des ménages et leur revenu s'y applique donc.
Ainsi, dans un pays pratiquant un régime de changes flottants, lorsque l’État parvient à équilibrer les mouvements de capitaux, le solde courant de la balance des paiements est toujours nul. La conséquence en est que, dans ces circonstances, le modèle keynésien retrouve toute sa validité.
La théorie de l'avantage comparatif
La théorie keynésienne ne permet cependant pas de comprendre à elle seule tous les problèmes d'une économie ouverte sur l'extérieur. La théorie de l'avantage comparatif présentée par l'économiste David Ricardo en 1817 est encore aujourd'hui largement dominante dans les milieux économiques. Elle vise à démontrer que le libre-échange permet une spécialisation des pays dans les activités où ils disposent d'un avantage comparatif et que cette spécialisation est bénéfique à tous les pays, y compris les moins compétitifs.
La théorie de l'avantage comparatif a été développée pour démontrer les avantages du libre-échange. Aujourd'hui, avec la mondialisation et la grande diversité des produits, il est impossible pour un pays de vivre en autarcie, quelle que soit sa taille. De plus, des traités internationaux comme le GATT visent à favoriser le libre-échange. La question n'est donc plus vraiment de savoir si le libre-échange est bénéfique ou non mais plutôt de chercher à comprendre quelles sont ses conséquences sur les pays.
Une économie de libre-échange sans mouvements des capitaux ni de main-d'œuvre
Cette situation correspond à celle étudiée par Ricardo. Dans ce cas, Ricardo montre qu'une économie va se spécialiser dans les activités où elle présente des avantages relatifs en termes de coût. Il est cependant utile de reformuler la théorie ricardienne en disant que si le libre-échange est généralisé, c'est le marché mondial qui impose la structure des prix relatifs de l'ensemble des produits, c'est-à-dire que le rapport entre les prix de deux produits donnés sera le même pour tous les pays.
En effet, si dans un pays un produit est relativement cher par rapport au niveau mondial, il sera avantageux de l'importer en contrepartie de l'exportation d'autres produits de telle sorte que la concurrence ramènera les prix relatifs au niveau mondial. Inversement, si un produit est relativement moins cher dans un pays, il sera profitable de l'exporter en contrepartie de l'importation d'autres produits.
Puisque le marché mondial fixe la structure des prix relatifs aussi bien pour les produits finals que pour les produits intermédiaires, il fixe aussi la structure des valeurs ajoutées. Lorsqu'il existe différents niveaux de qualification de la main-d'œuvre, la structure des valeurs ajoutées impose aussi la structure des salaires relatifs des différentes catégories de salariés. En effet, il est possible, notamment grâce à la sous-traitance, de fragmenter les processus de production de manière à spécialiser les entreprises dans un type particulier de main-d'œuvre.
Si, dans un pays, la main-d'œuvre peu qualifiée est relativement chère par rapport au marché mondial, alors les prix des produits réalisés par des entreprises utilisant principalement de la main-d'œuvre peu qualifiée seront également relativement chers et il sera plus avantageux de les importer. Les salariés peu qualifiés qui ne pourront trouver d’emploi dans le secteur présentiel seront alors condamnés au chômage ou à accepter une baisse de leur salaire.
Ainsi, en l'absence de mouvements des capitaux et de la main-d'œuvre, le marché mondial impose non seulement la structure des prix relatifs mais aussi celle des salaires relatifs dans le secteur concurrentiel.
Une économie de libre-échange sans mouvements de capitaux mais avec libre circulation de la main-d'œuvre
Lorsque les salariés peuvent circuler librement d'un pays à l'autre, ce ne sont plus seulement les salaires relatifs des différentes qualifications qui sont fixés par le marché mondial, mais les salaires absolus, c'est-à-dire les salaires exprimés en une unité monétaire internationale. Les salariés iront, en effet, là où ils sont les mieux rémunérés. Un pays qui pratiquerait des salaires inférieurs à ceux des autres pays se trouverait confronté à une pénurie de main-d’œuvre.
Il est important de souligner qu'il n'est pas nécessaire que toutes les catégories de salariés puissent circuler librement d'un pays à l'autre, il suffit que l'une d'entre elles ait cette possibilité pour que le marché mondial impose un niveau absolu de salaire à chaque catégorie. En effet, si une catégorie de salariés bénéficie de la liberté de circulation, son salaire sera fixé en niveau par le marché mondial, comme le marché mondial impose dans tous les cas la structure des salaires relatifs, alors ce sont les salaires de toutes les catégories de salariés qui seront déterminés en niveau absolu par le marché mondial.
Par exemple, supposons que les salariés très qualifiés puissent circuler librement et que le marché mondial fixe leur salaire exprimé en unité monétaire internationale à 200. Supposons également que le marché mondial impose que les salariés peu qualifiés aient un salaire égal à la moitié de celui des salariés très qualifiés, alors le salaire des salariés peu qualifiés sera nécessairement égal en niveau absolu à 100.
Ce résultat est extrêmement important car, dans la réalité, il existe toujours au moins une catégorie de salariés bénéficiant de la libre circulation. Les salariés très qualifiés sont généralement très mobiles, ils parlent la langue internationale et, avec la mondialisation, ils retrouvent dans tous les pays des modes de consommation et des cultures proches des leurs.
Or, s'il est théoriquement possible de contrôler l'immigration, il est dans un pays démocratique impossible de s'opposer au départ des salariés les plus qualifiés. Comme, par ailleurs, ils sont partout les bienvenus du fait de leur rareté relative, les salariés très qualifiés constituent une main-d'œuvre mobile qui permet au marché mondial d'imposer à toutes les catégories de salariés le niveau de leur salaire réel.
Cependant, lorsque les salariés peuvent circuler librement, ils n’iront pas nécessairement vers les salaires les plus élevés mais là où ils trouveront les meilleures conditions de vie.
Dans cette situation, ce n’est donc non plus le salaire mais le pouvoir d'achat réel des salariés qui est fixé par le marché. En effet, les salariés dont le pouvoir d'achat est inférieur au niveau déterminé par le marché mondial seront tentés de quitter leur pays. Inversement, ceux dont le pouvoir d'achat réel est supérieur au niveau déterminé par le marché mondial se verront concurrencés par des salariés venant du monde entier.
Le pouvoir d'achat réel des salariés est déterminé non seulement par leur salaire mais aussi par trois éléments :
- les impôts qu'ils payent ;
- les services publics gratuits dont ils bénéficient ;
- le coût des services protégés qu'ils consomment.
L'efficacité des services publics joue ici un rôle important. Comme ils pèsent sur le pouvoir d'achat des salariés du fait des impôts qui servent à les financer, ils doivent être compétitifs en termes de rapport qualité/coût par rapport aux services publics des autres pays.
Les autres services du secteur présentiel doivent également être compétitifs car ils interviennent aussi dans la détermination du pouvoir d'achat réel des salariés du secteur exposé à la concurrence internationale.
Une économie de libre-échange avec libre circulation de la main-d'œuvre et des capitaux
Avec la mondialisation, les techniques et donc la productivité du travail tendent à s'égaliser, le salaire horaire tend alors à devenir la principale cause de disparité du coût du travail d'un pays à l'autre.
Lorsque les capitaux peuvent circuler librement, leur rémunération tend aussi à s'aligner sur le niveau mondial. Ainsi, lorsque la main-d'œuvre et les capitaux peuvent circuler librement d'un pays à l'autre, ce sont les rémunérations du travail et du capital qui sont fixées par le marché mondial.
Un pays qui voudrait maintenir la rémunération du capital à un niveau inférieur à celui fixé par le marché mondial ne pourrait plus financer ses investissements, un pays qui voudrait maintenir la rémunération d'une certaine catégorie de salariés au-dessus du niveau mondial la condamnerait au chômage.
La guerre économique
Lorsqu'on combine la théorie keynésienne et la théorie des avantages comparatifs, on comprend que les États se livrent une véritable guerre économique.
La théorie keynésienne nous apprend que l'accumulation est le moteur de l'activité économique. Dans la mesure où la croissance mondiale est faible, notamment suite à l'épuisement des ressources naturelles, l'investissement net mondial est très faible. L'accumulation devient alors l'enjeu d'une bataille féroce que se livrent les pays car, faute d'accumulation globale, l'accumulation d'un pays ne peut venir que de l'appauvrissement d'au moins un autre pays. Concrètement, il s'agit de dégager des excédents de la balance courante des paiements et cela par tous les moyens possibles.
La théorie keynésienne nous apprend aussi que la meilleure arme d'un pays est incontestablement sa compétitivité sur le marché des biens et services. Mais la compétitivité doit se comprendre de deux manières :
- compétitivité par la qualité des produits ;
- compétitivité par les prix.
La théorie des avantages comparatifs nous apprend que, dans une économie mondialisée, il est difficile pour un pays de s'imposer durablement par la faiblesse de ses prix car ceux-ci ont tendance à être déterminés par le marché mondial. C'est donc sur le terrain de la qualité que se joue la bataille. Or, cette bataille se déroule sur le long terme car la qualité est le résultat d'efforts continus et prolongés. Il n'est pas possible de l'améliorer par des mesures de court terme ayant rapidement des effets comme la dépréciation de la monnaie ou le creusement des déficits publics.
Certains pays peuvent être tentés d'échapper à la concurrence en limitant leurs importations mais la mondialisation a permis de rentabiliser les dépenses de recherche et développement sur de très grandes séries. Elle impose donc à tous les pays, y compris les plus grands, une ouverture de leurs frontières aux biens et services. Ceux qui voudraient se limiter à leur marché intérieur seraient condamnés à perdre la bataille technologique et donc la bataille de la qualité.
Mais la compétitivité d’un pays ne se réduit pas à la qualité de ses produits, elle dépend aussi de sa règlementation, notamment dans le domaine social et environnemental. La règlementation du travail pèse sur les coûts de production des entreprises, non seulement par les salaires et les charges sociales qu’elle impose mais aussi par les conditions d’embauche et de licenciement, par la qualité de vie et la sécurité au travail qu’elle garantit aux salariés.
L'influence de la réglementation est également déterminante sur les coûts de production induits par les mesures de protection de l'environnement. C’est un problème grave. En effet, la dégradation de l'environnement causée par la production ou la consommation n’est pas un coût pour l'entreprise mais pour la société, si bien qu’une entreprise sous la pression de la concurrence ne va pas spontanément prendre des mesures pour la réduire. Seule une réglementation contraignante peut imposer aux entreprises des processus de production plus écologiques car ceux-ci se traduisent généralement par des coûts supplémentaires.
Dans une économie mondialisée où les capitaux, les marchandises et les technologies circulent librement, les différences de coût de production entre les pays tendent à provenir de moins en moins de facteurs purement économiques et de plus en plus de facteurs liés à la réglementation. Il devient donc de plus en plus difficile pour un pays qui souhaite maintenir un haut niveau de protection sociale et environnementale de concurrencer les pays moins exigeants sur ce point. L'abaissement des normes de protection sociales et environnementales devient ainsi une arme dans la compétition internationale au même titre, et même davantage, que les dévaluations compétitives.
Les pays qui refusent de s'engager dans une telle voie doivent nécessairement se protéger. Pour cela, le contrôle des mouvements de capitaux paraît la mesure la mieux adaptée car elle redonne à l’État une possibilité d’action sans remettre en cause la liberté de circulation des biens et services.
Auteur : Francis Malherbe
- La théorie générale
- L'essentiel de la théorie
- Vidéos Youtube
- Principes fondamentaux de la comptabilité nationale
- Histoire de la comptabilité nationale
- Le champ de la comptabilité nationale
- Le système des comptes
- Les opérations sur biens et services
- Entreprises et ménages
- Valeur ajoutée, revenu et épargne
- Les administrations publiques
- Banques et assurances
- Le reste du monde
- Séquence simplifiée des comptes
- Tableaux des ressources et des emplois
- Prix et volumes
- Le produit intérieur brut
- Produits de la propriété intellectuelle
- Les comptes de patrimoine
- Extensions du système
- L'arbitrage
- Théorie économique et comptabilité nationale
- Exercices de comptabilité nationale
- Débats
- Des comptes d'entreprises aux comptes nationaux
- Secteurs et branches
- Séquence complète des comptes
- Agrégats et principales opérations
- Nomenclatures et comptes
- Le système européen des comptes
- Comptes nationaux
- Vidéos Youtube
- Ce site n'utilise pas de cookies, ne collecte aucune information sur ses visiteurs et ne comprend pas de publicité

